Tu as peut-être déjà vécu cette situation : une collègue qui te sourit en face, mais critique ton travail dans ton dos, une amie qui te complimente tout en te comparant secrètement, ou encore une inconnue sur les réseaux sociaux qui t’envoie un message haineux sur ton physique.
Ces comportements ne viennent pas toujours des hommes.
Parfois, ce sont des femmes qui les perpétuent.
La compétition féminine toxique est un phénomène bien réel, souvent ignoré ou minimisé par peur de diviser les femmes.
Pourtant, il est urgent d’en parler, car il mine nos solidarités et renforce le patriarcat.
Comment se fait-il que, dans un système qui nous oppresse, nous en venions à nous opprimer entre nous ?
Dans cet article, nous allons explorer :
- Les formes concrètes que prend cette rivalité (travail, réseaux sociaux, relations amoureuses).
- Les causes profondes (socialisation genrée, pression patriarcale, intériorisation de la misogynie).
- Comment en sortir (sororité, déconstruction individuelle, changements structurels).
Prépare-toi, car certaines vérités pourraient te piquer. Mais c’est nécessaire pour avancer.
Les visages de la compétition féminine toxique
1. En entreprise : le mythe de la « Reine des Abeilles »
En 1973, les psychologues G.L. Staines et R.J. Epstein ont identifié le « Queen Bee Syndrome » (Syndrome de la Reine des Abeilles) : des femmes en position de pouvoir qui, au lieu d’aider d’autres femmes à progresser, les rabaissent ou les excluent.
Une étude de Harvard Business Review (2018) montre que 60 % des femmes en leadership admettent avoir été victimes de sabotage par une autre femme.
« Elle a coulé ma promotion en disant que j’étais trop émotive, alors qu’elle-même pleurait en réunion la semaine dernière. » (Témoignage anonyme, forum Corporate Ladies).
Pourquoi ? Parce que dans un monde où les postes de pouvoir sont limités pour les femmes, certaines adoptent une mentalité de « survivante » : « Si je les laisse passer, je perds ma place. »
2. Entre amies : les coups bas déguisés en compliments
« Tu es tellement courageuse de porter cette robe avec tes cuisses ! »
« Wow, tu assumes vraiment de ne pas te maquiller ? »
Ces petites piques, souvent dites « pour rire », renforcent l’idée que nous sommes en compétition permanente.
Une enquête de Glamour (2020) révèle que :
- 78 % des femmes ont déjà été critiquées par une amie sur leur poids.
- 62 % ont reçu des « conseils non sollicités » sur leur apparence.
La sociologue Jessica Bennett appelle cela « l’agression passive féminine » : une hostilité indirecte, socialement acceptée parce que « entre filles, c’est normal ».
3. Sur les réseaux sociaux : le piège de la comparaison
Instagram, TikTok, Twitter… Ces plateformes exacerbent les rivalités.
Le phénomène des « hate comments » entre femmes :
« T’as vu ses lèvres ? C’est du botox cheap. »
« Elle se la joue naturelle, mais regardez sa taille photoshopée. »
Le « stan culture » (fanatisme pour une célébrité) qui dégénère en attaques contre d’autres femmes (ex. les « Beyhive » vs les « Rihanna Navy »).
Une étude de Cyberpsychology Journal (2021) montre que les femmes sont trois fois plus susceptibles de recevoir des commentaires méchants… d’autres femmes.
Les racines de la compétition féminine toxique : un héritage patriarcal
La rivalité entre femmes n’est pas un hasard.
Elle est le produit d’une socialisation genrée qui nous apprend, dès l’enfance, à nous percevoir comme concurrentes plutôt qu’alliées.
Le patriarcat a intérêt à nous diviser : des femmes qui se déchirent entre elles ne s’unissent pas pour le renverser.
1. L’éducation : apprendre à rivaliser pour exister
Dès le plus jeune âge, les petites filles reçoivent des messages contradictoires.
On leur dit d’être gentilles, mais pas trop effacées ; jolies, mais pas vaniteuses ; intelligentes, mais pas arrogantes.
Cette pression constante crée un terrain fertile pour la compétition.
Prenez les contes de fées : dans Blanche-Neige, la méchante reine est punie pour sa vanité, tandis que l’héroïne est récompensée pour sa douceur et sa beauté passive.
Dans Cendrillon, les belles-sœurs sont ridiculisées pour leur ambition, alors que l’héroïne est sauvée par sa docilité.
Ces récits enseignent aux filles que, pour être aimées, elles doivent être parfaites et que toute autre femme représente une menace.
À l’école, cette dynamique se poursuit !
Les filles sont souvent encouragées à être « sage » et « polie », tandis que les garçons peuvent se chamailler sans conséquences.
Résultat ? Les conflits entre filles deviennent plus subtils, plus indirects : des rumeurs, des exclusions, des critiques voilées sous des compliments.
2. La pression patriarcale : survivre dans un système hostile
En grandissant, cette rivalité prend une dimension plus insidieuse : celle de la misogynie internalisée.
Pour s’intégrer dans un monde dominé par les hommes, certaines femmes adoptent des comportements masculinisés, y compris le mépris envers d’autres femmes.
Un exemple frappant vient du monde professionnel.
Une étude de l’Université d’Arizona (2017) a révélé que les femmes en position d’autorité sont souvent plus sévères envers leurs subordonnées féminines que ne le sont les hommes.
Pourquoi ? Parce qu’elles ont intériorisé l’idée que pour être prises au sérieux, elles doivent se distancier des stéréotypes féminins, y compris la solidarité entre femmes.
Cette logique se retrouve aussi dans les relations amoureuses.
Combien de fois avons-nous entendu : « Je préfère traîner avec des mecs, les filles sont trop dramatiques » ?
Cette phrase, souvent prononcée sans méchanceté, reflète une forme de mépris envers les femmes, considérées comme « trop émotives » ou « trop compliquées ».
Pourtant, ce sont les mêmes traits qui, chez les hommes, sont tolérés, voire admirés.
Briser le cycle : vers une sororité radicale
Il ne suffit pas de constater le problème, il faut agir.
La sororité ne consiste pas à nier nos différences ou nos conflits, mais à les affronter avec honnêteté, pour construire des alliances plus solides.
1. Reconnaître nos propres mécanismes de compétition
Avant de changer les autres, il faut se regarder en face.
Combien de fois avons-nous :
- Jugé une femme pour sa tenue, en pensant « Elle cherche trop l’attention » ?
- Minimisé les succès d’une collègue, sous prétexte qu’elle « a de la chance » ?
- Ressenti un pincement de jalousie en voyant une autre femme rayonner ?
Ces réactions ne font pas de nous des « mauvaises féministes ».
Elles montrent simplement à quel point nous avons intériorisé l’idée que la réussite des autres femmes diminue la nôtre.
2. Construire des solidarités concrètes
La sororité ne se limite pas à des discours. Elle exige des actions :
En entreprise : refuser de participer aux commérages toxiques.
Soutenir les propositions d’autres femmes en réunion.
Mentorer une jeune collègue plutôt que de la voir comme une rivale.
Entre amies : célébrer les succès des autres sans arrière-pensée.
Arrêter les compliments backhanded (« Tu es trop courageuse de porter ce short ! »).
Sur les réseaux sociaux : ne pas liker les commentaires méchants.
Soutenir les créatrices au lieu de les critiquer pour des détails.
Un exemple inspirant ?
L’initiative « Pay Up Hollywood », où des femmes de l’industrie du cinéma ont partagé leurs salaires pour lutter contre les inégalités.
Résultat : des augmentations pour des centaines de professionnelles.
Conclusion
La compétition féminine toxique n’est pas une fatalité.
Elle est le résultat d’un système qui a tout intérêt à nous voir divisées.
Mais chaque fois que nous choisissons la sororité plutôt que la rivalité, nous sapons les fondements du patriarcat.
Cela ne signifie pas que nous devons tout accepter des autres femmes.
Les conflits existent et c’est normal !
Mais nous pouvons les affronter sans reproduire les schémas misogynes que l’on nous a enseignés.
Alors, la prochaine fois que tu ressentiras ce réflexe de compétition, pose-toi une question : « Est-ce que ce comportement me sert, ou sert-il le système ? »
Parce qu’au final, notre plus grande force réside dans notre capacité à nous soutenir.
Et comme l’a dit l’activiste Florynce Kennedy : « Libérez-vous, et le reste suivra. »
As-tu déjà pris conscience d’un moment où tu as reproduit de la compétition toxique ?
Comment pourrais-tu transformer cette prise de conscience en action ?
À lire aussi : 5 Insultes que l’on jette aux femmes alors qu’elles révèlent les échecs des hommes
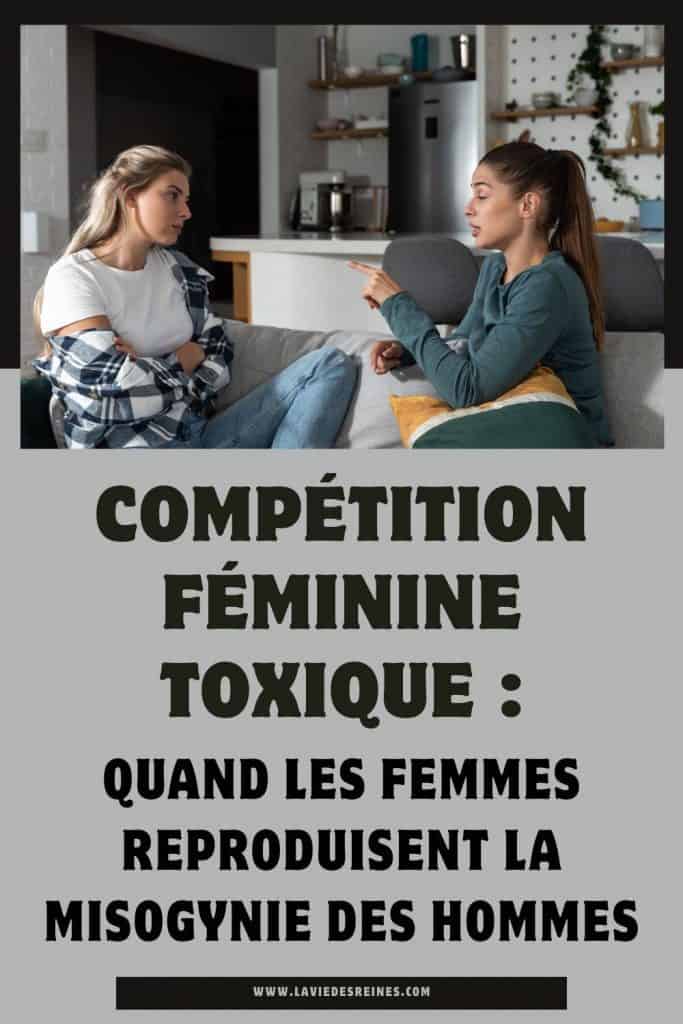


Pourquoi mettre un terme à une relation peut être la meilleure chose pour vous
Il s’est avéré que le Prince charmant n’était en fait rien d’autre qu’une définition plutôt fidèle du psychopathe. Voilà ce qui t’attend si tu restes dans une relation amoureuse avec un homme toxique!