On te l’a seriné à l’infini, comme une formule magique censée tout résoudre : « Pense positif, et tu iras mieux. »
Sauf qu’un trauma ne se dissout pas sous une pluie de citations inspirantes ou de posts Instagram sur la résilience.
La douleur n’est pas un manque de volonté, et la guérison ne se mesure pas à ta capacité à sourire en public.
Combien de fois as-tu entendu « Faut avancer » prononcé d’un ton léger, comme si ton chagrin était un caprice ?
Combien de proches t’ont conseillé de « voir le bon côté des choses » alors que tu luttais simplement pour respirer ?
Cette injonction à la positivité n’est pas seulement inefficace : elle est cruelle.
Elle transforme ta souffrance en échec personnel, comme si tu n’avais pas « assez travaillé sur toi » pour mériter la paix.
Pire encore, ce discours nie la réalité des mécanismes psychologiques.
Un trauma s’imprime dans le corps, dans les réflexes, dans ces nuits où tu te réveilles en sursaut sans raison apparente.
On ne soigne pas une brûlure au troisième degré avec des pensées heureuses.
Alors, pourquoi prétendre que des mots vides suffisent à réparer l’irréparable ?
La vérité, la voici : non, tu n’es pas folle de ne pas « t’en remettre » en claquant des doigts.
Non, ce n’est pas « dans ta tête ». Et surtout, personne n’a le droit de te dicter comment traverser ce que lui-même n’a jamais eu à affronter.
Le mythe du « Positive Vibes Only »
La positivité toxique, ce n’est pas de l’optimisme.
C’est une chape de plomb qu’on nous impose pour éviter d’entendre ce qui dérange.
« Ne sois pas négative » signifie trop souvent « Ne me parle pas de ce qui me met mal à l’aise. »
Prends l’exemple de Sarah, qui a osé confier sa dépression post-rupture à une amie.
Réponse reçue : « Mais au moins, t’es jeune et jolie ! Concentre-toi là-dessus. »
Sous couvert d’encouragement, ce genre de remarque invalide l’expérience de la souffrance.
C’est comme dire à quelqu’un avec une jambe cassée qu’il devrait « être reconnaissant d’avoir l’autre jambe en bonne santé ».
Les études en psychologie le confirment : refouler ses émotions pour « rester forte » aggrave l’anxiété et prolonge le processus de guérison.
Une recherche publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology montre que les personnes forcées à adopter une façade positive développent une détresse interne bien plus profonde.
Et pourtant, la société continue de glorifier cette fausse résilience.
Les réseaux sociaux regorgent de coachs en développement personnel qui te vendent des « 10 étapes pour effacer ton passé », comme s’il s’agissait d’une tâche à cocher sur une to-do list.
Mais le trauma ne fonctionne pas comme un logiciel qu’on désinstalle.
Quand Emma a perdu son père, on lui a répété « Il voudrait que tu sois heureuse » comme une évidence.
Personne ne lui a dit : « Tu as le droit de hurler, de te rouler en boule, de ne pas savoir comment survivre à ce vide. »
Résultat ? Elle a mis des années à réaliser que sa douleur était légitime.
Les étapes réelles de la guérison
La guérison authentique ne suit pas un script estampillé « success story ».
Elle ressemble plutôt à un chemin chaotique, avec des rechutes, des nuits blanches et des questions sans réponse.
Première étape : la colère.
Pas celle qu’on exprime poliment dans un journal intime, mais celle qui te fait jeter des assiettes contre le mur.
Celle qui te réveille à 3 h du matin avec une liste mentale de tout ce que tu aurais dû dire.
Cette colère n’est pas un échec. C’est une réaction saine à l’injustice subie.
Ensuite vient le deuil.
Pas celui des autres, qui s’attendent à ce que tu « passes à autre chose » après trois mois.
Non, le vrai deuil : ces jours où tu pleures dans ta voiture en écoutant cette chanson, où tu réalises soudain que certaines blessures ne « partent » pas.
Elles deviennent simplement une partie de toi, comme une cicatrice qui ne fait plus mal au toucher, mais reste visible.
Enfin, l’intégration.
Pas « l’oubli », pas « la victoire », mais le moment où tu comprends que ce qui t’a brisée ne te définit pas.
Où tu peux mentionner son nom sans que ton estomac se noue.
Où tu réalises que la guérison, ce n’est pas revenir à l’avant, mais construire un après malgré tout.
Ce qu’on devrait nous dire
Au lieu de « Pense à l’avenir », essayons : « Je suis là pour écouter ton présent, même s’il est sombre. »
Au lieu de « Tout arrive pour une raison », préférons : « Ce qui t’arrive est injuste, et ta rage est justifiée. »
Des thérapies alternatives comme l’EMDR ou l’écriture expressive ont prouvé leur efficacité bien plus que les mantras positifs.
Une étude de l’Université de Texas a démontré que coucher ses traumatismes sur papier réduit les symptômes dépressifs de 30 % en six semaines.
Quand Léa a commencé à boxer après sa rupture abusive, ses proches ont trouvé ça « extrême ».
Pourtant, frapper un sac de sable lui a appris une vérité essentielle : certaines douleurs doivent être physiquement expulsées pour cesser de nous hanter.
Conclusion
La prochaine fois qu’on te sortira un « Faut voir le bon côté », rappelle-toi : les émotions ne sont pas des ennemies à éradiquer, mais des messagères à écouter.
Ta douleur mérite mieux que des platitudes. Elle mérite d’être entendue, crue, honorée.
Pas parce qu’elle te rend plus forte, mais simplement parce qu’elle existe.
Et si quelqu’un te reproche de ne pas « avancer assez vite », réponds-lui ceci : « Je ne suis pas un algorithme. Je suis un être humain. Et ma guérison n’a pas de deadline. »
Partage si tu en as marre des raccourcis qui minimisent les combats invisibles.
À lire aussi : 3 Exercices pour guérir d’un trauma amoureux
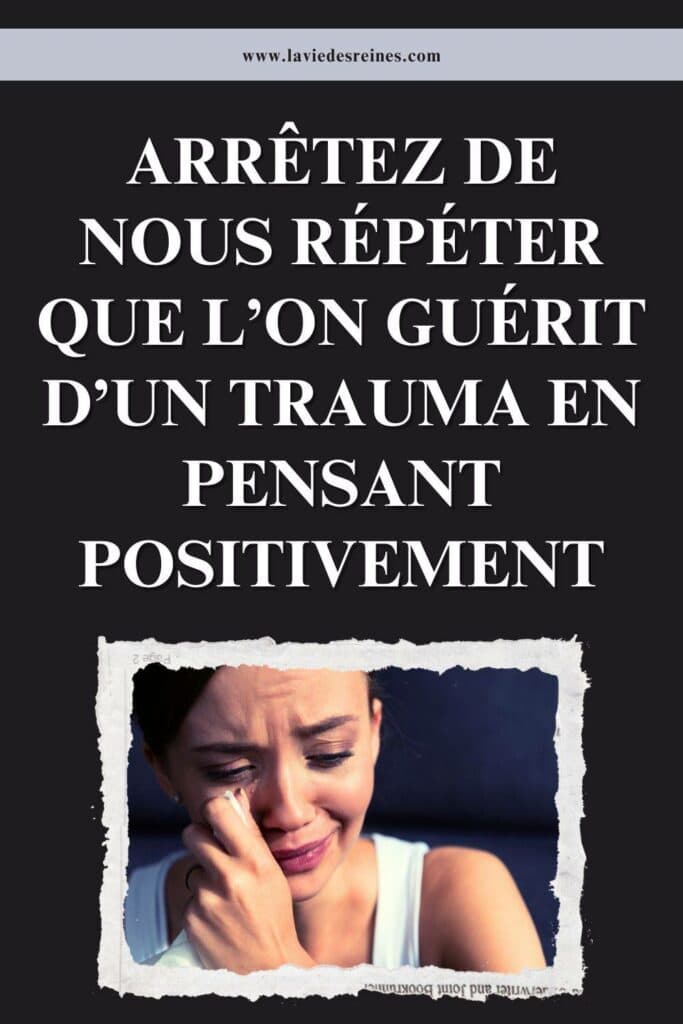


Pourquoi mettre un terme à une relation peut être la meilleure chose pour vous
Il s’est avéré que le Prince charmant n’était en fait rien d’autre qu’une définition plutôt fidèle du psychopathe. Voilà ce qui t’attend si tu restes dans une relation amoureuse avec un homme toxique!