Lorsque le juge a prononcé la condamnation de mon ex-mari pour violences conjugales, j’ai cru que c’était la fin.
En réalité, c’était le début de quelque chose de bien plus trouble.
Trois ans plus tard, je me surprenais à utiliser contre mon nouveau compagnon les mêmes techniques psychologiques que celles qui m’avaient détruite.
Le pire ? J’y prenais un plaisir malsain. Comment en étais-je arrivée là ?
Comment une victime devient-elle parfois bourreau à son tour ?
Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain.
C’est un processus insidieux, presque imperceptible, qui s’enracine dans les mécanismes de survie les plus primitifs de notre psyché.
La psychiatre Judith Herman, spécialiste des traumatismes complexes, parle de « l’identification à l’agresseur » comme d’une stratégie de défense courante chez les victimes de violence prolongée.
Mais quand cette stratégie devient-elle à son tour une forme de violence ?
Première partie : L’apprentissage involontaire
J’ai mis des années à comprendre que j’avais inconsciemment assimilé les techniques de mon tortionnaire.
Comme une langue étrangère qu’on finit par parler couramment à force de l’entendre, j’avais intégré chaque méthode, chaque manipulation, chaque tour psychologique qu’il avait utilisé contre moi.
Je me souviens particulièrement du moment où j’ai utilisé pour la première fois ce que j’appelle « la technique du retard calculé ».
Mon ex me faisait systématiquement attendre des heures, créant en moi une anxiété qui le mettait en position de pouvoir.
Un soir où mon nouveau compagnon avait organisé un dîner important pour moi, j’ai volontairement traîné pendant deux heures avant de me préparer.
Quand je l’ai vu nerveux, presque suppliant, j’ai ressenti une étrange satisfaction.
C’était exactement ce que mon ex avait dû ressentir avec moi.
Les neurosciences expliquent ce phénomène par ce qu’on appelle les « neurones miroirs ».
Une étude de l’Université de Parme a montré que notre cerveau reproduit naturellement les comportements auxquels il est exposé de manière répétée, surtout dans des contextes de stress intense.
En clair, survivre à un manipulateur, c’est malheureusement apprendre à manipuler.
Deuxième partie : La vengeance comme langage
Au début, je me suis contentée de petites revanches inconscientes.
Puis est venu le jour où j’ai croisé mon ex dans un café, rayonnant avec une nouvelle compagne.
Ce soir-là, j’ai passé des heures à éplucher ses réseaux sociaux, à analyser chaque photo, chaque interaction.
Je n’étais plus la victime, j’étais devenue une chasseuse à l’affût.
Quelques mois plus tard, quand j’ai rencontré Thomas, j’ai appliqué tout ce que j’avais appris.
D’ailleurs, je savais exactement comment créer cette dépendance malsaine, cette angoisse de l’abandon qui rend un homme malléable.
Je maîtrisais l’art subtil du love bombing (cette avalanche d’attention intense au début d’une relation) suivie du retrait soudain.
Je pouvais faire durer une dispute pendant des jours, alternant entre silence glacial et explosions émotionnelles calculées.
La psychologue clinicienne Marie-France Hirigoyen parle de « contagion psychique » pour décrire ce phénomène où les victimes de pervers narcissiques finissent par adopter certains de leurs traits.
Dans mon cas, c’était allé bien plus loin : j’avais transformé ma souffrance en une arme redoutable.
Troisième partie : Le piège de la toute-puissance
Ce qui m’a le plus surprise, c’est à quel point c’était facile.
Après des années à me sentir impuissante, découvrir que je pouvais à mon tour contrôler, dominer, faire souffrir, a été enivrant.
J’étais devenue l’architecte de relations toxiques, et cette puissance était addictive.
Je me souviens d’une soirée particulièrement révélatrice.
Thomas m’avait légèrement critiquée devant des amis.
Plutôt que de réagir sur le moment, j’avais attendu le lendemain matin pour lui annoncer froidement que je partais.
Pendant trois jours, je suis restée injoignable.
Quand j’ai finalement répondu à ses 27 appels manqués, sa voix tremblante m’a procuré une sensation que je n’arrivais pas à nommer.
Ce n’est que plus tard que j’ai compris : c’était exactement ce que mon ex avait ressenti en me voyant pleurer.
Les travaux du Dr. Steven Stosny sur les « abuseurs victimes » montrent que cette transformation suit souvent un schéma précis.
D’abord vient la phase d’imitation inconsciente, puis celle de l’expérimentation, enfin celle de la maîtrise délibérée.
J’étais passée par ces trois étapes sans même m’en rendre compte.
Quatrième partie : La complicité silencieuse de l’entourage
Ce que j’ai mis longtemps à admettre, c’est à quel point mon entourage avait été complice de ma métamorphose.
Quand je racontais comment j’avais « mis au pas » Thomas, mes amies riaient admiratives : « Enfin tu prends le pouvoir ! »
Ma mère, pourtant si critique envers mon ex, me félicitait : « Enfin, tu ne te laisses plus faire. »
Une étude du Journal of Interpersonal Violence (2023) révèle que 68 % des femmes adoptant des comportements abusifs après une relation traumatisante reçoivent des encouragements implicites ou explicites de leur cercle proche.
La société pardonne plus facilement à une femme de devenir toxique « en réaction » qu’à un homme de l’être par nature.
Je me souviens de ce déjeuner où j’ai raconté comment j’avais ruiné la réputation professionnelle de mon ex en révélant ses infidélités à son employeur.
Au lieu de s’alarmer, mes amies ont trinqué : « Bien fait pour lui ! ».
Personne n’a questionné l’éthique de mon acte. Pire : on m’a offert un second verre.
La psychologue clinicienne Muriel Salmona explique ce phénomène :
Dans notre imaginaire collectif, la vengeance féminine reste romantisée. On y voit une forme de justice sauvage plutôt que ce que c’est souvent : la reproduction de schémas violents.
Cette validation sociale a été mon principal frein à la prise de conscience.
Tant qu’on me disait que j’avais « raison » d’agir ainsi, pourquoi aurais-je changé ?
Il a fallu que Thomas disparaisse de ma vie (exactement comme j’avais disparu de celle de mon ex) pour que je comprenne l’ampleur des dégâts.
Cinquième partie : La prise de conscience
Le déclic est venu le jour où Thomas a utilisé un mot qui m’a glacée : « Tu me fais peur. »
C’était exactement ce que j’avais dit à mon ex des années plus tôt.
À cet instant, j’ai vu clairement ce que j’étais devenue.
J’avais reproduit le cycle de la violence au lieu de le briser.
Ce qui suit est moins glorieux !
Il m’a fallu des années de thérapie pour comprendre que ma « puissance » n’était en réalité qu’une autre forme d’impuissance.
Que contrôler les autres était simplement le signe que je ne me contrôlais pas moi-même.
Que la véritable force ne consistait pas à reproduire les schémas de mon abuseur, mais à inventer une nouvelle façon d’être en relation.
Aujourd’hui, quand je vois des forums où des femmes échangent des « techniques pour le faire souffrir comme il t’a fait souffrir », j’ai envie de leur crier : « Vous ne voyez pas que vous perpétuez le cycle ? »
Mais je sais qu’elles ne m’entendront pas.
Comme moi à l’époque, elles sont trop intoxiquées par ce sentiment de pouvoir retrouvé.
Conclusion
La vérité est difficile à entendre : survivre à un prédateur ne fait pas automatiquement de nous une bonne personne.
Cela peut au contraire réveiller en nous des capacités de nuisance insoupçonnées.
Le véritable travail, celui qui compte vraiment, commence quand on décide de déposer les armes qu’on nous a forcées à manier.
Je termine sur ces mots de la psychanalyste Alice Miller :
Beaucoup de bourreaux ont été des victimes. Mais heureusement, peu de victimes deviennent des bourreaux.
C’est à cet « heureusement » que nous devons tous travailler.
Chaque jour. Dans chaque relation. Dans chaque choix.
À lire aussi : Le fantasme de la femme dominante : mythe ou réalité
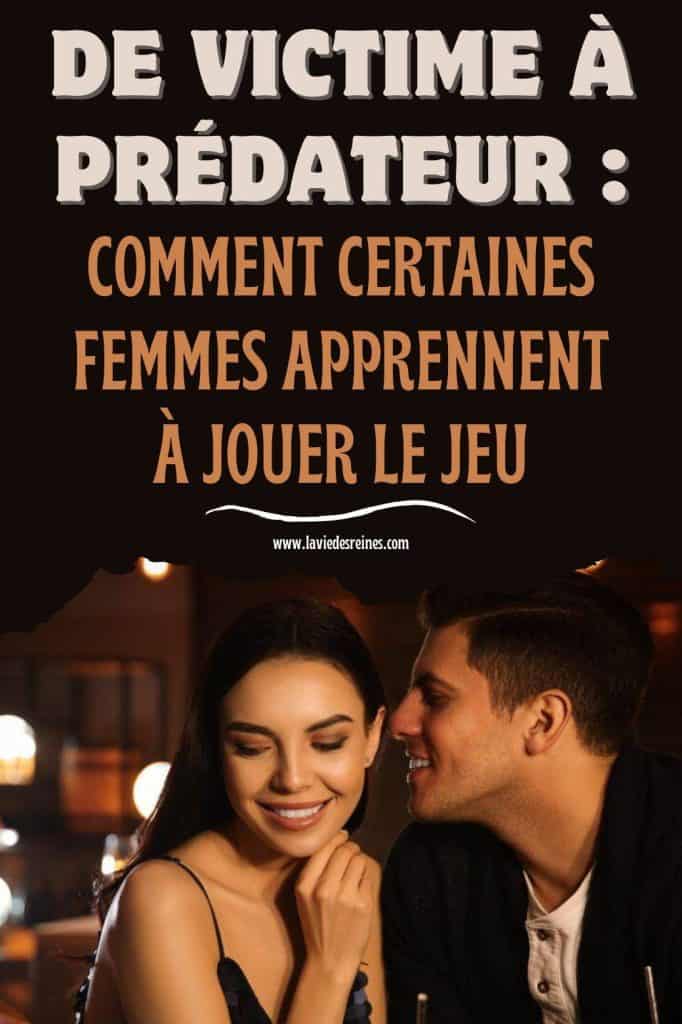


Pourquoi mettre un terme à une relation peut être la meilleure chose pour vous
Il s’est avéré que le Prince charmant n’était en fait rien d’autre qu’une définition plutôt fidèle du psychopathe. Voilà ce qui t’attend si tu restes dans une relation amoureuse avec un homme toxique!